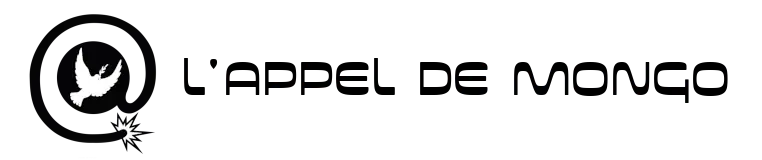Synthèse
Claire A. – 20 ans – 2ème année Architecture et Engineering – Strasbourg
Sensibilité littéraire : éclectique, Marc Levy, Guillaume Musso.
LIVRE COMPLET ♥♥♥ 8/10*
Volume I ♥♥♥♥ 9
Volume II ♥♥ 7
Volume III ♥♥♥ 8
Volume IV ♥♥♥ 8
* la note chiffrée estime la qualité littéraire formelle et la note de cœur l’adhésion intime
En une formule
Quand la force de l’humanité naîtra de la force de chacun d’entre nous.
En quatrième de couverture
Un combat décisif nous attend pour sauver l’humanité avant qu’il ne soit trop tard.
Le compte à rebours est annoncé dans ce roman dystopique d’un genre nouveau qui ne se compare à rien d’existant. Pendant qu’il nous immerge dans une réalité parallèle très élaborée pour nous entraîner dans une aventure captivante avec des personnages attachants en quête du remède universel, il nous tend en même temps constamment le miroir de notre monde contemporain où règne le pouvoir de la Communication. Le cocktail d’ensemble produit un éveil de conscience décisif : il existe une issue pour notre humanité en grand péril à condition de nous mettre en mouvement collectivement à travers le pouvoir de notre goutte d’eau.
Ce pouvoir, il appartient à chaque lecteur d’aller à sa rencontre tandis que le livre nous confronte à nous-même jusque dans la plus grande profondeur, là où est tapie notre peur, notre culpabilité, notre inconscience la plus inavouable qu’il nous faut accepter avec lucidité pour nous en délivrer. Car c’est de notre transformation intérieure seule que pourra émerger un nouveau monde régénéré.
Et on sort de cette épreuve réconcilié avec la vie et avec soi-même, dans une confiance neuve en notre pouvoir créateur illimité. Notre horizon bouché s’ouvre à la lumière où tout redevient possible. L’enthousiasme renaît, avec une envie d’agir à notre niveau pour contribuer à créer un monde meilleur, car nous savons désormais que nous en avons les moyens et que tout est entre nos mains.
Questionnaire
Quelle impression générale vous a fait le livre et qu’est-ce qui le qualifierait le mieux ?
Il m’a permis de croire qu’ensemble tout est possible, que nous sommes tous responsables du monde dans lequel on vit.
Ce livre est riche, surprenant, inspirant et bénéfique pour les consciences.
Que vous a-t-il apporté ?
Une nouvelle vision du monde. On a tendance à se dire qu’il ne va pas si mal que ça, parce qu’on n’ose pas affronter l’horreur qui nous entoure.
Si les choses ne changent pas, notre futur peut devenir très mauvais.
A-t-il éveillé votre conscience dans certains domaines ? Si oui, lesquels ?
J’ai pris conscience de plusieurs aspects de la vie et j’ai un nouveau regard sur différents sujets :
– La notion de Peur, que l’on s’inflige souvent à soi-même.
– Les besoins fondamentaux des « quatre richesses » à cultiver chaque jour.
– L’attention à la réalité de l’Autre et le don désintéressé.
Ce sont des aspects du livre que je souhaite développer dans mon quotidien.
Maintenant que vous l’avez terminé, percevez-vous sa cohérence d’ensemble et les liens nécessaires des différentes séquences dans le développement des thèmes ?
Oui. Certaines séquences dont je ne percevais pas la raison d’être ont pris leur sens dans les volumes suivants (le baron Ungern, scène d’amour…)
Maintenant que vous l’avez terminé, percevez-vous la raison d’être de l’anonymat de l’auteure en lien avec le sacerdoce des mongonastiques ? La trouvez-vous justifiée et nécessaire ?
Oui. Le livre propose une vision de l’avenir et des solutions sur la façon de l’améliorer.
Afficher un nom d’auteur reviendrait à dire que quelqu’un à trouvé la « clé » pour aider l’humanité, ce qui ne correspond pas aux valeurs des mongonastiques.
Considérez-vous que le livre peut avoir un impact bénéfique sur la conscience collective ?
Oui. Il peut ouvrir les consciences et amener l’humanité et chaque individu à se remettre en cause.
Selon vous, est-il accessible au grand public ?
Je pense que non. Il faut partager certaines valeurs avec l’auteure et avoir un esprit ouvert pour percevoir le but de l’œuvre.
Selon vous, a-t-il un potentiel de succès de librairie ?
Oui.
Une fois publié, le conseilleriez-vous à vos proches ?
Oui.
Volume I
♥♥♥♥ 9
Commentaire
J’ai été portée par l’accroche très prenante de la première partie. Je l’ai lue très vite sans presque pouvoir m’arrêter, tenue en haleine par le suspens. C’est aussi très bien écrit, agréable et facile à lire, ce qui ajoute à l’aisance de s’absorber dans l’histoire.
Je retiens plus particulièrement la relation entre la mère et l’enfant qui est touchante et pleine de sensibilité. Comme le père est absent, l’enfant est pour elle seule avec tout l’amour et la responsabilité de veiller à son bien-être. Le conflit qu’elle endure entre son désir de le garder et sa conscience de devoir le perdre en faisant le bien véritable de l’enfant qui l’attire ailleurs dans l’inconnu est d’une grande intensité. Son tourment la conduit finalement à aller au-delà de l’égoïsme pour faire le meilleur choix pour le bien de son enfant. Elle sacrifie son amour possessif en révélant l’amour pur et désintéressé qu’elle lui a toujours porté, et tous les sentiments qui s’expriment entre elle et son enfant à ce niveau-là sont très beaux.
L’arrivée « accidentelle » de Djack au village a été une vraie surprise lorsque j’ai découvert en même temps que la mère qu’il était le précepteur. Ça a encore plus intensifié le suspens qui tourne autour de Mongo en laissant entendre qu’il pourrait contrôler les destins, et donc manipuler toutes les situations pour contraindre la mère à faire le choix de lui donner son enfant malgré elle, puisque dès le départ elle a affirmé sa ferme volonté de le garder.
Bien qu’elle ne fait qu’une courte apparition, la petite Cerise est aussi un personnage touchant, et la trisaïeule avec ses manières extravagantes est assez comique.
Sur la deuxième partie, lorsqu’on aborde le monde sombre des basses villes pour arriver jusqu’au baron Ungern, ça part dans une direction complètement différente qui coupe avec le récit initial, autant dans sa forme qui devient choquante et trash que dans son fond. Il montre la noirceur et le malheur du monde qui reflètent davantage ce vers quoi l’humanité est en train de s’enfoncer, par opposition au bonheur de vivre du village qui reste un rêve ou une utopie.
Ça m’a fait un peu décrocher pour me sentir frustrée de ne plus être portée par l’élan initial du récit qui m’a si bien plu, mais je l’ai retrouvé ensuite quand on quitte ce monde sombre pour revenir dans la lumière du Mongonastère, où on accompagne à nouveau les enfants dans un récit d’une grande sensibilité, avec des relations touchantes et pleines d’humanité.
Je note que j’ai été marquée par la leçon de vie de Zabir donnée aux enfants sur la peur, qui est une réponse salutaire à la peur aveuglante à laquelle sont soumis tous les humains des basses villes. Elle m’a fait m’interroger sur ma propre relation à la peur en me transmettant un enseignement pour m’en détacher.
Le livre I se termine avec une séquence dans la cellule de transfert qui ravive tout le mystère de Mongo. Le suspens sur ce qu’il pourrait bien être est complètement relancé. Je ne veux rien anticiper pour ne pas être déçue si ça ne devait pas correspondre à mes attentes. Je préfère me laisser surprendre, ce qui attise d’autant plus mon envie de lire la suite.
Ce qui pourrait être amélioré ou corrigé
Rien à corriger. Ma remarque sur le monde sombre du baron Ungern avec son écriture choquante et trash n’est pas un défaut en soi. Je ne suis pas accoutumée à ce style violent qui heurte ma sensibilité, mais je reste convaincue qu’il n’est pas gratuit et a sa raison d’être dans ce grand livre dont j’espère avoir la compréhension en poursuivant ma lecture.
Volume II
♥♥ 7
Commentaire
J’ai lu ce deuxième volume avec plus de difficulté, principalement la partie essai à laquelle j’ai eu du mal à accrocher, mais je souhaite toutefois poursuivre la lecture du volume III.
J’ai par contre très bien accroché à la première partie de ce volume II qui dévoile les énigmes initiales en révélant la cohérence de l’univers de Mongo. Tout trouve sa place autour de l’enjeu du Mongonastère de faire évoluer la Communication pour améliorer le sort de l’humanité, notamment la présence du baron Ungern qui y apparaît comme son nécessaire contraste. La description de l’évolution de Mongo au cours des âges est agréable à lire et à découvrir. Il apparaît comme un aboutissement d’une intelligence artificielle et pourtant il reste toujours aussi mystérieux et insaisissable, tout comme les boules noires qui recèlent son douzième degré de conscience. Les trois Règles qui le régissent est une belle idée qui donne une vraie assise au développement du monde de la Communication par l’intermédiaire de ses mutations. Ça établit le lien avec les Danseurs, la solidarité des mongonastiques qui œuvrent ensemble en apportant chacun leur goutte d’eau, tandis qu’on suit les étapes menant aux douze mutations avec intérêt dans cette construction imaginaire qui obéit à une logique très pertinente. C’est ce passage qui me met le plus en attente du volume III en laissant pressentir l’avènement de la treizième mutation que je suis curieuse de découvrir.
La description de l’industrie des croquants est bien vue également. Elle montre de manière extrême comment la publicité nous manipule, ce qui m’a amenée à mieux reconnaître son impact et son omniprésence désormais admise dans notre vie, notamment dans sa manière de stimuler artificiellement notre faim en nous poussant à manger au-delà des besoins du corps, ce qui ne peut qu’être néfaste à notre santé.
La deuxième partie commence par un long essai socio-économique qui met entre parenthèses le récit. Je me suis sentie frustrée de devoir ainsi décrocher de l’intrigue qui me tenait en haleine. Son contenu ne m’a pas vraiment attirée et m’a plutôt ennuyée, à l’exception de quelques idées originales comme la culture des quatre richesses que j’ai prise en note pour son grand intérêt. La monnaie d’attention qui apparaît plus loin en rapport avec la création monétaire m’a marquée elle aussi pour sa pertinence évocatrice, parce qu’elle reflète bien l’exigence d’attention de plus en plus nécessaire dans notre société d’aujourd’hui pour marquer notre place professionnelle et autre.
Je me suis sentie plus à l’aise avec le texte lorsqu’il renoue ensuite avec les dialogues. Il a à nouveau stimulé mon intérêt, et j’avoue que je préfère cette forme narrative qui me permet de m’identifier aux personnages dans l’action. En suivant les échanges de Carlos et de Thomas dans le présent de leur situation, je m’identifie plus facilement à eux avec la sensation de partager leur vie, ce qui rend le récit plus dynamique et vivant.
La crise du Dicteur est bien perçue. C’est en s’écoutant lui-même qu’il parvient à la guérison de son doute. Il finit par retrouver le meilleur de lui-même et la paix intérieure, et donc la plus grande des quatre richesses.
La découverte des Musiciens dans les ateliers montre l’art désintéressé des mongonastiques dont le don créateur est pour recevoir et pour donner. La scène finale entre les deux garçons est touchante. Elle met en avant les univers très différents dont ils sont issus qui n’empêchent pas leur relation fusionnelle, révélant un besoin l’un de l’autre où ils se complètent.
Ce qui pourrait être amélioré ou corrigé
Le long essai socio-économique m’a fait décrocher du dynamisme du récit. Je ne dirai pas pour autant que c’est un défaut qui doit être corrigé en le retirant ou en le réduisant. Difficile de trancher, car s’il est moins attrayant et plus difficile à lire, donc d’un accès moins grand public sur ce passage, il enrichit néanmoins le livre en donnant plus de substance aux thèmes abordés.
Volume III
♥♥♥ 8
Commentaire
J’ai besoin d’être stimulée par l’action et l’interaction des dialogues pour rester prise dans un récit, c’est pourquoi je préfère ce style de roman. Mais je dois dire que j’ai été agréablement surprise par la dernière partie sur la longue introspection de Thomas, donc sans action et sans dialogue. J’ai beaucoup accroché à son contenu qui m’a bien parlé, et pour la première fois j’ai pu suivre cette forme narrative avec un vrai intérêt.
Ce qui m’a attirée d’emblée dans ce passage est sa façon de nous faire percevoir la réalité comme un cadeau. La vie est un cadeau qui nous est donné. A nous d’en prendre soin et de bien en profiter, ce qui demande seulement de rester en accord avec elle en faisant le bien. Car la liberté est donnée à l’homme, nous pouvons choisir la vie que nous voulons mener, mais cette liberté de choisir implique que nous sommes responsables de nos actes et de leur conséquences que nous devons assumer. Cela renvoie alors à la responsabilité de notre goutte d’eau qui reste décisive pour créer ensemble un monde meilleur.
La longue réflexion sur la mort m’a beaucoup plu également. Elle est présentée dans une perception positive où elle fait partie de la vie. En faisant le parallèle avec la mort de l’enfance nécessaire pour donner naissance à l’adolescence, elle montre que notre vie est parsemée de petites morts et de renaissances qui sont à chaque fois des passages d’un état ancien à un état nouveau qui sont indispensables au renouvellement du courant de vie. La mort finale du corps qui nous attend tous est présentée dans cette perspective qui nous fait pressentir qu’elle n’est elle aussi qu’un passage nécessaire pour un renouvellement plus grand dans lequel quelque chose de notre conscience persiste, tout comme nous n’avons pas perdu notre conscience de soi en passant de la mort de l’enfance à la naissance de l’adolescence. Rien de dogmatique n’est cependant affirmé sur la mort. Elle garde tout son mystère en se tenant à sa réalité factuelle de saut dans l’inconnu, mais on en ressort avec un sentiment apaisé, une plus grande acceptation de la mort et plus de confiance en ce qui nous attend dans l’inconnu. C’est l’expérience de Thomas qui accepte toujours plus la mort avec bonheur en même temps qu’il s’abandonne toujours plus à la vie qui nous transmet cette impression positive. Mais puisque son destin de Danseur l’appelle au sacrifice de sa vie, je me demande s’il ne va pas mourir dans la suite du récit, comme si son acceptation de la mort était une façon de se préparer à être le treizième Danseur accompli.
Pour revenir au début du récit, j’ai été marquée par l’apparition de l’Ogre. On partage le frisson de peur qui anime Thomas jusqu’à ce qu’il le découvre en ouvrant la porte. J’ai été surprise d’apprendre qu’il s’agissait d’un Danseur qui avait échoué à la mutation. Ne reste plus de lui que le mal qu’il a refoulé durant son éducation où il s’efforçait de ne présenter que le meilleur de lui-même, et qui est ressorti au moment de la mutation en le possédant tout entier. L’Ogre renvoie alors aussi à la part obscure ou mauvaise que l’on refoule en soi, ce qu’exprime bien le pressentiment de Thomas de porter l’Ogre en lui.
Quand il expérimente la perdition des ténèbres avec son ami Carlos et qu’ils s’en sortent parce qu’ils sont restés attachés par la main, c’est une belle image de solidarité qui montre qu’à deux on est plus forts pour affronter une épreuve.
La traversée de l’épreuve leur fait accéder au sanctuaire des Danseurs accomplis où les attend le Dicteur. Il décide de briser la Règle de sa charge en leur faisant des révélations interdites. J’ai trouvé très intéressant ce moment où il abandonne une perfection formelle d’éducation pour se montrer plus humain et plus proche des deux garçons. Il leur donne sa goutte d’eau en étant réceptif à leur humanité commune, ce qui ne peut qu’élever leur confiance mutuelle et leur sentiment d’œuvrer tous ensemble au même but. De cette façon, il leur apporte finalement beaucoup plus que s’il s’était contenté de respecter la Règle.
J’ai aussi bien aimé l’évolution de Thomas à l’intérieur de ce troisième volume. A son premier rendez-vous avec Mafat, il se montre d’abord supérieur et dominateur. Puis sa rencontre avec l’Ogre va le libérer de sa peur profonde. A partir de là, son sentiment de supériorité disparaît puisqu’il réalise que c’était avant tout un rempart pour se protéger de sa peur de l’autre. S’il a un don exceptionnel, ça n’en fait pas pour autant un être supérieur. Et de découvrir qu’il n’est fondamentalement pas différent des autres, qu’il est au même niveau qu’eux le libère de son isolement d’Élu et lui procure de l’apaisement.
Il est alors mûr pour rencontrer Mafat pour de bon parce qu’il se sent à présent avec elle de l’intérieur, au même niveau qu’elle. Il découvre la sexualité et la dimension de l’amour, où sa vie austère de mongonastique laisse place à de l’attachement pour un autre être. Il renoue ainsi avec sa part d’affection humaine comme il a pu la connaître avec la petite Cerise dans son village. Mais ce moment marque aussi son passage à l’âge adulte où il s’ouvre à l’autre et assume ses sentiments.
Ce qui pourrait être amélioré ou corrigé
Dans la dernière partie, j’ai fini par perdre le fil dans le deuxième grand passage en italiques. S’il était deux fois plus court en restant sur l’essentiel, je pense que ça ne se produirait pas.
Volume IV
♥♥♥ 8
Commentaire
J’ai été contente de retrouver Mafat en ce début de volume, et attristée pour elle et Thomas dans la scène de leur rupture. Cette scène met en avant leur amour très puissant en le confrontant à leur histoire qui était impossible dès le départ. Le fait que Mafat soit prête de passer pour une sorcière en détournant un mongonastique de sa mission est une idée forte, de même que Thomas qui préfère renoncer à sa mission de sauver l’humanité pour laquelle il est venu au Mongonastère plutôt que de quitter Mafat. Elle montre bien l’intensité de leur passion qui les enferme dans un amour égoïste qui se fait au détriment des autres. C’est pourquoi leur amour passionnel est sans issue, parce qu’il reste chargé de souffrance pour tous. Et leur grande souffrance qui va atteindre jusqu’à Carlos est très bien ressentie. On a de la peine pour ce qu’ils endurent.
On découvre alors un autre Thomas qui a perdu le goût de la vie. Son mal-être l’amène à visiter l’Ogre. A travers lui, il veut se convaincre que Mafat est responsable de son mal, que c’est sa faute si il souffre et non la sienne. La voie de l’Ogre est donc d’agir sur Mafat pour se libérer de sa souffrance puisqu’il lui fait croire qu’elle en est la cause, que c’est en lui imposant sa volonté pour qu’elle se plie à son désir qu’il ira mieux.
Tout cela prépare sa confrontation avec Gunj qui va l’amener à sa guérison en l’éclairant sur la vraie nature de son mal. Il lui fait bien voir que Mafat ne peut pas être la source de son malheur parce qu’elle n’est pas non plus la source de son bonheur. Thomas est enfermé dans son mal où il est son propre bourreau comme son propre sauveur. Cette réalité me renvoie au volume I où elle a déjà été abordée concernant la peur inutile qu’on s’inflige à soi-même. Thomas doit donc aller à l’intérieur de lui pour trouver la source de son mal-être qu’il doit éliminer, avant de pouvoir renouer avec la source de son bien-être qui ne dépend de rien d’extérieur.
On voit que Gunj a le pouvoir de le guider vers sa guérison parce qu’il est un être illuminé qui est lui-même parvenu à se guérir de toute souffrance en atteignant la vérité. Comme Bouddha, c’est un sage réalisé tout à fait crédible qui donne un poids d’authenticité aux vérités spirituelles qu’il énonce. C’est comme ça qu’il m’a fait accrocher aux deux personnalités en nous, la vraie et la fausse, la consciente et l’inconsciente, que je trouve très révélatrices. J’ai aussi été marquée par son enseignement sur les trois actes, le négatif, le neutre, et le positif, qui m’a apporté une vraie prise de conscience sur la négativité masquée de l’acte neutre.
Dans sa dernière confrontation avec Gunj, Thomas doute encore de lui-même. Il ne ressent pas l’envie de sauver l’humanité car il n’a pas cette force de dévouement et de sacrifice. Et c’est seulement en découvrant Mafat qui porte un enfant que le désir de sacrifice va s’éveiller naturellement en lui. J’ai trouvé que c’était là une belle scène pleine de sens pour conduire à la fin du roman. Mafat y apparaît comme l’incarnation du Bien, de la douceur maternelle et de la force d’amour universelle. L’impulsion de Thomas à se sacrifier n’est plus contrainte mais devient l’élan spontané de son amour pour les enfants à venir de l’humanité.
Ce qui pourrait être amélioré ou corrigé
J’ai trouvé la confrontation entre Gunj et Thomas dans la première partie qui mène jusqu’à sa guérison trop théorique. Il y a trop d’insistance sur la souffrance de Thomas, notamment le passage où il se connecte au cœur ensanglanté de Mafat jusqu’à parvenir à sa guérison. C’est très théorique et statique. Ça passerait mieux si c’était réduit à l’essentiel.
J’ai d’abord été frustrée de ne pas savoir qui de Thomas ou de Carlos allait être l’Élu pour accomplir la Treizième Œuvre. Puis j’ai finalement apprécié l’idée qu’ils l’accompliraient ensemble, puisqu’elle ne peut être qu’une œuvre collective. De cette façon la fin est libre, et c’est aussi bien, car on peut imaginer ce qu’on veut.